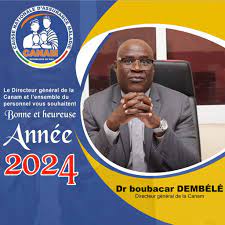Culture > Yamarou photo : « un photographe, c’est un visionnaire, un archiviste »

Yamarou photo : « un photographe, c’est un visionnaire, un archiviste »
mardi 1er novembre 2022, par
C’est une nouvelle tendance chez les artistes : se regrouper en collectifs. Exemple de la photographie, avec Yamarou photo, à la fois un groupe pour la création, un centre de formation et de résidences d’artistes, et un lieu d’échange et de réflexion sur l’évolution de la discipline, créé en 2018.
Kany Sissoko est une des « chevilles ouvrières » de Yamourou Photo. La jeune femme souriante, cheveux coupés courts, chemise large très colorée, nous parle, très détendue. On voit tout de suite que l’artiste est une non conformiste, avec un fort caractère. Cette diplômée de l’Institut National des Arts de Bamako a eu la chance de faire un stage de photographie au Musée national, en 2009. Pour elle, tout démarre à ce moment. Elle poursuit dès lors sa passion pour la photo et malgré les difficultés s’impose dans ce milieu. Primée à l’Inter-Biennale de la photographie en 2019, Kani commence à avoir une notoriété internationale.
Elle défend avec conviction la mission du collectif : travailler avec la population est essentiel, il ne s’agit pas seulement de montrer la photo dans les galeries ou les musées, insiste-t-elle. « On a constaté que notre communauté n’a pas d’éducation culturelle, elle n’a pas l’habitude de voir la photographie comme d’autres disciplines artistiques, la danse et autres… Raisons pour laquelle notre travail est de montrer une autre dimension de la photographie aux populations. »
L’autre aspect essentiel est la formation : « Lors de nos master classe, on fait appel aux artistes doyens qui viennent partager leurs connaissances, leur expérience. Pas seulement des photographes, d’ailleurs. L’important est le partage entre les artistes. Et puis un de nos objectifs principaux est de devenir une vraie école de photographie. »
La passion avant tout
« C’est une passion ! Nous sommes tous des passionnés de photo. Je ne connais personne parmi nous qui fait autre chose que la photo. Même si on a des styles et des activités différents (les photos de mariage, la photographie d’art, la photographie de reportage) ».
Aux dires de Kany, on peut vivre de la photographie. Parmi les professionnels maliens, il y a des chefs de familles qui vont vivre leur famille avec la photo. Mais il est vrai qu’on gagne davantage à l’étranger qu’au Mali. Son espoir est que cela puisse changer dans l’avenir.
La profession vient de loin : il n’y a pas si longtemps la photographie au Mali était considérée comme un travail d’homme ; et un petit boulot à faire en attendant. « Parce que, avant, si tu faisais des photos, on te demandait si tu n’avais pas trouvé de travail. On ne considérait pas la photographie comme un vrai métier. Les gens se sont habitués à croire que la photographie est réservée seulement aux mariages, et là-bas on n’est même pas respecté… Aujourd’hui, même s’il n’y a pas vraiment de marché photographique au Mali, beaucoup nous encouragent, d’autres nous appellent pour nous dire qu’ils apprécient ce qu’on fait, il y a de l’espoir ! »
Kani Sissoko précise que le travail collectif n’impacte pas de façon négative sa production personnelle. « Je fais des productions personnelles en dehors du collectif. Chacun de nous qui travaille dans le collectif a son propre chemin. On continue de s’entraider, on travaille ensemble sur des projets, même s’il s’agit des projets d’œuvre de chacun ».
Le projet phare : la formation
Le projet phare de Yamarou est de travailler avec la population malienne, d’aider la communauté à comprendre davantage l’art en général et la photographie en particulier. Ainsi Yamarou photo a récemment réalisé un projet de renforcement de capacités, en ciblant d’autres jeunes issus du groupe fragile des talibés, à Mopti.
Sidiki Haïdara, photographe, également formateur à Yamarou, a un diplôme en histoire et archéologie. « Moi et la photographie, témoigne-t-il, c’est depuis l’enfance ! J’étais le photographe de notre grain. »
M. Haidara explique que le collectif s’engage auprès des jeunes dans toutes les disciplines de la photographie. Surtout avec l’avènement du shooting, un procédé issu de la photographie de mode, beaucoup de jeunes sont tentés par la photo, et cela rapporte sur le plan pécuniaire. En plus du renforcement de capacité des jeunes, Sidiki Haïdara s’intéresse à leur motivation : « l’objectif est de savoir s’ils sont intéressés dans ce domaine. » Il indique que, dans l’année, Yamourou forme plus d’une vingtaine de jeunes.
A Yamarou photo, l’amusement n’empêche pas le sérieux !
Seydou Camara se consacre à la photographe depuis 2007. Il est le fondateur et le directeur artistique de Yamarou photo. La création du collectif est venue suite à une forte demande de formation des jeunes. Il s’agissait aussi de faire prendre conscience aux Maliens, photographes y compris, que Bamako est la capitale africaine de la photographie, grâce à la fameuse Biennale lancée en 1994. Quelques écoles d’art, telles que l’INA et le Conservatoire Balafasseké, accompagnent cette rencontre qui est la première et principale manifestation internationale dédiée à la photographie et à la vidéo africaine sur le continent.
Le nom Yamarou, d’après son fondateur, veut dire celui qui crée chaque jour. « Si tu es à Yamarou, tu es appelé à créer chaque jour, tu ne dois plus te voir comme les autres. Ce qui fait que Yamarou est devenu aujourd’hui un concept, »Yamarouya » : la devise de Yamarou photo est ‘’l’amusement n’empêche pas le sérieux’’. Yamarou n’est pas seulement une association, mais c’est aussi une famille, dit-il. Tout le monde se retrouve ici. « Yamarou, c’est un concept triangulaire autour de la créativité, la cohésion et le courage. A Yamarou photo, on accepte tout le monde sauf une seule personne, le paresseux. A Yamarou, tout monde le travail ensemble comme un champ collectif, et tout le monde travaille pour soi-même, et s’entraide », fait savoir Seydou Camara.
Le défi, pour un artiste, est de se faire connaitre. Certes, avec l’internet et les réseaux sociaux, Seydou Camara reconnait que c’est plus facile qu’autrefois. Mais pour devenir un artiste confirmé, il faut du temps. « Car il faut t’accepter et te faire accepter par les autres. Il faut avoir la patience. On ne peut pas être un grand artiste du jour au lendemain, devenir comme Abdoulaye Konaté, sans travailler, sans la patience. Il faut accepter d’être formé, de lire Beaucoup, il faut regarder les œuvres des autres artistes ».
« Mon regard de la photographie au Mali est positif »
« Mon regard de la photographie au Mali est positif », ajoute Seydou Camara. « On a eu la chance d’avoir de grands artistes photographes connus dans le monde entier : Seydou Keita, Malik Sidibé. C’est une fierté pour nous, ils sont notre repère. Aujourd’hui, c’est notre tour, la jeunesse doit faire face à elle-même et au monde. »
Oui, ajoute-t-il, la photographie nourrit son homme. « Mais il y a une manière de faire. Car le monde évolue et la photographie évolue. Nous sommes dans un monde de numérique, donc tu dois bouger avec le monde. Mais si tu es en retard tu ne peux pas vivre avec la photographie. »
« La photographie est au-delà de ce que les gens pensent. Un photographe, c’est un visionnaire, et un archiviste. Dieu a donné le pouvoir au photographe d’arrêter le temps ».
Bintou Coulibaly
Un nom qui remonte aux origines du Mandé
L’origine du mot Yamarou remonte à l’histoire du prince Mandé Bugari. Il s’agit du frère cadet du légendaire roi du Mandé, Sunjata Keïta, qui le suivit dans son exil à Méma. C’était un jeune homme d’une grande ingéniosité qui savait entreprendre et réaliser une panoplie de choses par lui-même, sans recevoir de quiconque un apprentissage préalable. Mandé Bugari est célébré à travers une chanson qui lui est dédiée et dont les paroles sont : Oh yamaru, l’amusement n’empêche pas le sérieux ; oui, telle est sa devise.
Mandé Bugari était surnommé Youmarou, autrement dit quelqu’un de remarquable par sa créativité, capable d’inventer de nouvelles choses et de renouveler le savoir et le savoir-faire (en bambara : min bé Kokura labo lon o lon). Manden Bugari a créé des pas de danses et des chansons incontournables dans le patrimoine culturel malien. Il a créé de ses propres mains de nouveaux instruments de musique, notamment le Djembé et ses rythmes. Il est aussi celui qui, le premier, a joué du Bolon et du Koro (tronc d’arbre évidé qui sert d’instrument de percussion). Il est à l’origine des rythmes de musique traditionnels dédiés aux femmes (musoyi donfoli) et des rythmes dédiés aux hommes (keyi donfoli), ainsi que des danses et réjouissances populaires auxquelles ses musiques sont associées. On trouve une histoire de Mande Bugari dans le livre de Drissa Diakité : « Kouyaté, la force de la parole ».
B.C.
Voir en ligne : Yamarou photo : « un photographe, c’est un visionnaire, un archiviste »