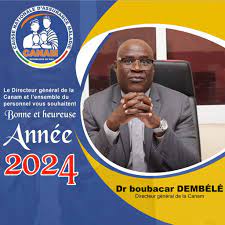Culture > Trafic illicite des biens culturels : Des douaniers, gendarmes, policiers et agents de musées et bibliothèques de (…)

Trafic illicite des biens culturels : Des douaniers, gendarmes, policiers et agents de musées et bibliothèques de manuscrits à l’école de la lutte
lundi 7 décembre 2020, par
Quel est l’état des lieux de la situation du trafic illicite au Mali en général et dans les régions nord et centre en particulier ? Quels sont les biens patrimoniaux les plus touchés par ce trafic ? Quels sont les mécanismes et outils de lutte existants et les actions à mener pour améliorer leur efficacité ? Comment renforcer le système de gestion et de contrôle des biens culturels à l’exportation en vue d’assurer une meilleure protection du patrimoine culturel ? Comment renforcer le système d’information et de communication entre les acteurs des forces de défense et de sécurité, les professionnels du patrimoine et les communautés locales pour des meilleurs délais de traitement des cas de trafic illicite ? Ce sont-là autant de questions qui seront traitées au cours d’un atelier organisé par le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, à travers le Musée Nationale du Mali.
Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, le Musée National du Mali abrite du 7 au 9 décembre 2020, l’ « Atelier de formation des agents des douanes, de la gendarmerie, de la police des frontières, des musées et des bibliothèques de manuscrits à la protection des biens culturels ».
Mme Kadiatou Konaré, ministre de la culture, de l’Artisanat et du Tourisme, a indiqué que cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert illicites des biens culturels. Selon elle, ce premier instrument de droit international, pour la protection des biens culturels en temps de paix, a été ratifié par 140 États dont le Mali, le 6 avril 1987.
« Cet atelier a pour objectifs d’assurer la protection du patrimoine culturel par un meilleur contrôle des biens culturels à l’exportation, amener les agents à connaître les outils de protection du patrimoine culturel, à savoir : les textes législatifs et réglementaires au niveau national et les conventions internationales, les procédures de délivrances des autorisations d’exportation, la (re) connaissance des types de biens culturels », a-t-elle indiqué.
Mme le ministre a rappelé que le Mali, berceau de grandes civilisations peut s’enorgueillir de posséder un patrimoine culturel dense. Entre autres, elle a cité une énorme quantité de trésors archéologiques, d’édifices, joyaux architecturaux de terre tels les mosquées de Djenné, de Tombouctou, des mausolées, etc. Elle a ajouté d’impressionnants éléments immatériels, fruits du génie créateur humain, contribuant au renforcement de la cohésion sociale à travers les pratiques d’alliances intercommunautaires : rites, cultes, objets et lieux de cultes, connaissances de l’univers, traditions orales fécondes, arts lyriques et chorégraphiques novateurs. « Malheureusement, comme beaucoup de pays africains, le Mali se trouve confronté aux problèmes de préservation de son riche patrimoine culturel, menacé de destruction, de pillage et de trafic illicite », a-t-elle regretté. Avant de rappelé que c’est à partir des années 1980, que le Mali s’est vu particulièrement touché par ce phénomène.
Selon Mme le ministre, dans le Delta intérieur du Niger, des pillages opérés sur des sites archéologiques ont exhumé plusieurs statuettes en terre cuite, qui ont été clandestinement exportées vers l’Europe. « D’autres sites comme ceux de Gao Sanè, de Djenné Djeno, du Pays Dogon, de Ségou et de beaucoup d’autres localités du Mali sont convoités en permanence par des pilleurs entretenus par des antiquaires affiliés à des réseaux de marchands d’art internationaux », a-t-elle ajouté. Avant de regretter le vol des objets ethnographiques communautaires et leur vente dans des réseaux.
Mais, aujourd’hui Mme le ministre pense que ce phénomène a été exacerbé par la crise multidimensionnelle de 2012, le conflit armé puis l’occupation des régions du nord du pays par de groupes armés prenant pour cible, le patrimoine culturel et les communautés de site. « Les conséquences de cette crise se sont manifestées par son lot d’exaction sur la population, de destruction des mausolées ostensiblement opérée, de trafic de tous genres constituant une menace réelle pour les objets, notamment les manuscrits », a-t-elle indiqué.
Avant de soutenir que dans le contexte d’internationalisation du marché des objets d’art, le trafic illicite des biens culturels constitue une industrie globale qui menace de piller, d’endommager ou même de détruire le témoignage historique et l’identité culturelle des peuples. « La hausse de la demande d’œuvres d’art et d’antiquités (à titre d’exemple, rien que sur l’année 2016, le marché mondial de l’art a généré près de 45 milliards d’USD de chiffres d’affaire selon le Rapport du TEFAF 2017) n’entraîne pas seulement le développement d’un marché de l’art prospère à l’échelle internationale, elle encourage également le trafic illicite de biens culturels, et donc les vols dans les musées, dans les collections privées et dans les édifices religieux, ainsi que la destruction irrémédiable de sites archéologiques et le pillage de bâtiments et de monuments », a-t-elle estimé.
C’est pourquoi, face à ce fléau qui a atteint une proportion inquiétante aujourd’hui, Mme le ministre a estimé qu’ il est essentiel pour le Mali, de renforcer les mécanismes existants et de mettre en place des stratégies appropriées susceptibles d’atténuer la destruction des sites archéologiques et de mieux contrôler le commerce illicite des trésors culturels.
« Pour lutter contre le phénomène, il paraît évident non seulement de recueillir le point de vue des communautés locales directement concernées par le phénomène, mais également créer un réseau interservices (professionnels du patrimoine, force de défense et de sécurité) en vue de définir et de mettre en œuvre des stratégies locales qui pourraient mieux les impliquer dans la mise en œuvre des plans et programmes adoptés par le gouvernement et les collectivités décentralisées », a-t-elle déclaré.
Mais avant, Ali Daou, responsable du programme culture à l’UNESCO à Bamako, a indiqué que « le vol, le pillage et le trafic illicite des biens culturels sont des crimes. Ils dépossèdent les peuples de leur histoire et de leur culture. Ils fragilisent la cohésion sociale des peuples touchés. Ils sont liés aux autres formes de trafic et contribuent au financement du terrorisme et d’autres ».
Il a rappelé que lors du 50e anniversaire de la convention 1970, célébré les 25 novembre, la Directrice générale de l’UNESCO a souligné que : « Vendre ou acheter délibérément une œuvre d’art volée, c’est porter atteinte à notre patrimoine universel. C’est priver l’humanité et les peuples de la mémoire sur laquelle peut se fonder leur avenir ».
« Face à la recrudescence du phénomène au Mali à cause de la crise multidimensionnelle que le pays connait depuis 2012, l’UNESCO avait conduit en 2016 une étude sur la question dans les zones les plus touchées », a-t-il indiqué. Avant de rappeler que l’atelier entre dans le cadre d’une des recommandations formulées par l’expert pour mieux sensibiliser les parties prenantes à ces fléaux pour une synergie d’action et de lutte commune. Il a rappelé qu’il se tient dans la suite logique de l’atelier pilote sur le même thème organisé les 17 et 18 février 2017 à Tombouctou et les deux ateliers qui en ont suivi respectivement à Bandiagara et Gao en novembre et décembre 2017.
Assane Koné