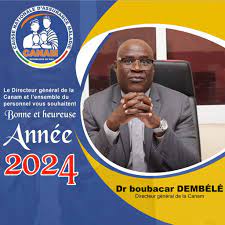Societe > Transformation des produits agro-alimentaires : Un cas de réinsertion réussie de femmes maliennes rapatriées de la (…)

Transformation des produits agro-alimentaires : Un cas de réinsertion réussie de femmes maliennes rapatriées de la Côte d’Ivoire
jeudi 20 octobre 2016, par
Les chiffres ne sont pas officiels. Mais, certains experts de la question de l’immigration pensent qu’il y a autant de femmes que d’hommes, parmi les 4 millions de maliens qui vivent à l’extérieur de leur pays. Rares étaient les femmes maliennes qui allaient à l’émigration. Mais, aujourd’hui, c’est un fait : Elles vivent les affres de l’émigration aux côtés des hommes et souvent n’arrivent pas à se réinsérer facilement au pays, à leur retour. Mme Coulibaly Oumou Coulibaly est la Présidente de l’Association des rapatriées maliennes (ARM) de Côte d’Ivoire. Dans le cadre de son association, elle conduit des activités génératrices de revenus. Comment Mme Coulibaly Oumou Coulibaly s’est retrouvée en Côte d’Ivoire ? Pourquoi elle est revenue au Mali ? Et, pourquoi avoir crée une association des rapatriées maliennes de la Côte d’Ivoire ? Lisez notre enquête !
« A notre retour au Mali. Au début, ça n’a pas été du tout facile. C’est après de multiples démarches qu’on a été compris. Et, on a été assisté par les autorités et par des Organisations non gouvernementales ». C’est par ces termes que Mme Coulibaly Oumou Coulibaly, Présidente de l’Association des rapatriées maliennes (ARM) de Côte d’Ivoire et non moins trésorière de la Fédération des associations de migrants au Mali (FAM), a introduit ses propos sur leurs difficultés de réinsertion au Mali, lorsqu’elles sont rentrées de la Côte d’Ivoire à cause de la crise Ivoirienne.
Partie en Côte d’ivoire, contre sa volonté en 1982, à la suite d’un mariage forcé, il a fallut attendre 2002, pour que Mme Coulibaly Oumou Coulibaly revienne définitivement s’installer au Mali. Ironie du sort. Un peu contre sa volonté, comme à son départ.
« Nous avons décidé de notre propre volonté de rentrer au Mali, mais il faut dire qu’on avait pas le choix. La crise politico-militaire qui a commencé en 2002, en Côte d’ivoire, nous a obligé de tout abandonner et de fuir ce pays. Nous sommes dans le cas de retour volontaire, mais forcé », nous a indiqué Mme Coulibaly Oumou Coulibaly.
Ce départ forcé de la Côte d’ivoire, un peu en catastrophe, par un convoi de cars affrétés par l’Etat du Mali, à travers l’Ambassade du Mali à Abidjan, pour le rapatriement de ses ressortissants qui le souhaitaient, n’est pas sans rappeler des souvenirs à Mme Coulibaly Oumou Coulibaly. « Je revenais au pays comme le jour de mon départ du Mali : un peu contre ma volonté. Si nombreuses sont de plus en plus les maliennes qui choisissent volontairement d’aller à l’émigration, ce ne fut pas mon cas », s’est-t-elle souvenue avec beaucoup d’amertume.
En 1982, au moment où Mlle Oumou Coulibaly, à l’époque jeune lycéenne pleine d’espoirs, était pressée de voir la fin des vacances scolaires pour affronter les examens pour l’obtention de la première partie du baccalauréat, après une année bien studieuse, elle sera surprise par une décision familiale. « Contre ma volonté, mon père venait de prendre la lourde décision de me donner en mariage à un cousin émigré en Côte d’Ivoire et ma fugue n’y fut rien », a-t-elle indiqué.
Immédiatement après la célébration du mariage, la décision fut prise par mon père de m’envoyer en Côte d’ivoire, rejoindre mon époux. « Je suis une victime de l’émigration par le fait d’un mariage forcé. Je n’avais jamais imaginé qu’un jour j’allais vivre en dehors du Mali », a-t-elle ajouté.
En sa qualité de responsable d’Association de maliennes rapatriées de la Côte d’Ivoire, elle est très au parfum des causes et de la prise de la décision du départ de ses sœurs maliennes. « Si dans mon cas la décision a été prise par mon père, après mon mariage forcé. Il faut reconnaître qu’il y a plusieurs cas de figures. Souvent, il y a des femmes mariées qui mettent la pression pour rejoindre le mari. Souvent, ce sont les maris qui exigent que leur femme vienne les rejoindre. Et, souvent, il y a des cas où se sont les deux familles qui se mettent d’accord pour le départ de la nouvelle mariée », a-t-elle indiqué. Avant d’ajouter que les motifs de départ sont aujourd’hui divers.
Selon Mme Coulibaly Oumou Coulibaly, si par le passé, la plupart des femmes maliennes allait à l’émigration pour rejoindre leur époux, aujourd’hui, tel n’est plus le cas. « Pays d’émigration par tradition, il faut admettre que depuis que le Mali a été identifié comme pays pauvre, le flux migratoire a pris des proportions et touche aujourd’hui fortement la gent féminine », a-t-elle estimé. Avant d’ajouter qu’aujourd’hui, il y a des femmes maliennes qui quittent le pays pour aller étudier ou pour aller apprendre un métier ou se perfectionner dans la pratique d’un métier. « A titre d’exemple, je peux vous citer le cas de nombreuses jeunes femmes maliennes qui vont aujourd’hui en Côte d’ivoire pour aller apprendre soit la coiffure, soit la couture », a-t-elle précisé.
Les propos de Mme Coulibaly Oumou Coulibaly, sont confirmés par Mme Diarra Mariam Savané, chargée de la promotion du genre et de l’autonomisation des femmes au Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur. « Il est vrai qu’avant les femmes maliennes partaient à l’émigration pour aller rejoindre leur conjoint dans le cadre du mariage. Mais, aujourd’hui, elles y vont aussi pour chercher de l’emploi, le bien être. En un mot pour aller chercher à avoir ce qu’elles ne peuvent pas avoir au pays pour aider leur famille », a-t-elle indiqué.
Devenue commerçante, à défaut de continuer les études
En ce qui concerne Mme Coulibaly oumou Coulibaly, tout porte à croire que si son père avait consenti au mariage contre la volonté de la principale intéressée, c’est parce que son futur gendre lui avait donné la certitude qu’une fois à Abidjan, elle allait reprendre l’école pour avoir ses diplômes et sûrement travailler ensuite.
« On m’avait promis que j’allais continuer les études. Mais, une fois chez mon mari, sa sœur s’est opposée à mon inscription dans une école quelconque pour avoir un diplôme », a-t-elle révélé.
A défaut d’aller à l’école, en 1984, pour fuir l’ennui et le désœuvrement dans une ville qu’elle venait de découvrir, Mme Coulibaly Oumou Coulibaly, sans formation professionnelle pour envisager un travail salarial, va s’adonner au petit commerçant.
Rapidement, elle va prendre goût à sa nouvelle activité qui se développait de jour en jour. « Pour augmenter mes marges bénéficiaires, j’ai décidé d’aller m’approvisionner au Ghana ou au Nigéria. N’eut été la crise ivoirienne, je serai sûrement entrain de mener cette activité qui me réussissait bien en Côte d’Ivoire », a-t-elle indiqué avec beaucoup de regret.
En effet, grâce aux ressources qu’elle engrangeait dans son activité commerciale en Côte d’Ivoire, pendant au moins 25 ans, Mme Coulibaly Oumou Coulibaly a soutenu sa famille au Mali. « Mon commerce marchait très bien et je prenais en charge ma mère restée au Mali. Je contribuais à hauteur de souhait aux dépenses scolaires de mes cinq petits frères et une petite sœur, qui m’a rejoint par la suite à Abidjan pour ses études », a-t-elle déclaré. Mieux, elle nous a indiqué qu’elle est aujourd’hui propriétaire de deux concessions à Bamako : Une achevée, actuellement en location et l’autre en cours de finition.
La carte de séjour ou le malheur des étrangers en Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire fut pendant longtemps une terre d’hospitalité et un havre de paix pour les ressortissants des Etats de la sous-région Ouest africaine. Mais, avec l’instauration de la carte de séjour à la faveur de la conjoncture économique que traversait le pays de Félix Houphouët Boigny, les choses devenaient plus compliquées pour les étrangers.
« A un moment donné, lors de notre séjour en Côte d’Ivoire, nous avons commencé à avoir des difficultés. Avec la carte de séjour, nous avons assisté à une chasse à l’étranger dans les rues d’Abidjan. Et, nous avons eu beaucoup de difficultés et surtout subi des humiliations au quotidien », a-t-elle indiqué. Avant d’ajouter qu’il n’était pas rare de voir des policiers arrêtés des étrangers qui ne possédaient pas la carte de séjour et les déshabillaient pour les mettre en rang dans la rue. « Déjà, à cette époque, j’avais un engagement militant et cela me permettait d’intervenir régulièrement pour régler de multiples problèmes de carte de séjours de mes compatriotes », a-t-elle révélé.
Mais, force est d’admettre que c’est pendant la crise politico-militaire qui a secoué la Côte-d’Ivoire que les étrangers et même des ivoiriens, ont subit le pire martyr de leur existence. « Pendant cette période, nous avons assisté à une violence inouïe. Aujourd’hui, quand j’y pense, j’ai la chaire de poule », nous indiqué Mme Coulibaly. Selon, elle, il y a eu plusieurs cas de femmes violées. Certaines ont perdu tous leurs biens, sans oublier les humiliations, les tortures et les pertes en vie humaine.
Après « l’enfer ivoirien », bonjour l’aventure au Mali
« C’est face à cette violence qui avait fini par installer un climat d’insécurité un peu partout sur le territoire ivoirien que l’Etat malien a organisé des rapatriements de volontaires dans des voyages groupés par cars », s’est souvenue notre interlocutrice. Elle est longuement revenue sur les difficultés de ces voyages où les cars devaient passer par le Ghana et le Burkina Faso, avant de rallier le Mali.
Mais, après ce voyage de 5 jours à une semaine, les rapatriés arrivés à Bamako, n’étaient pas au bout de leurs peines. Une autre épreuve les y attendait. Très enthousiastes de regagner leur pays, après avoir vécu des moments traumatisants en Côte d’Ivoire, les rapatriées vont devoir se résoudre à vivre une nouvelle aventure dans leur propre pays.
« Bien qu’ayant été rapatriés par l’Etat, nous n’avons pas trouvé un dispositif de réinsertion prêt en terme de programme au Mali. Une fois de retour au bercail, les rapatriés de la Côte d’ivoire étaient laissés à eux même, sans assistance », a-t-elle regretté. Avant d’annoncer que c’est la raison qui les a poussés à s’organiser en association pour réfléchir à des solutions pour leur réinsertion dans le tissu socio-économique du Mali.
« Après le retour, il fallait penser à la réinsertion. Le début n’a pas du tout été facile. Nous étions pour la plupart des mères de famille avec des enfants, les hommes ayant fait le choix de rester en Côte d’Ivoire pour préserver leur emploi difficilement acquis, dans l’attente du retour de l’accalmie », s’est-t-elle souvenue.
L’Association des rapatriées maliennes (ARM) est mise sur les fonds baptismaux. « Au début, notre association comptait 234 membres. Mais, aujourd’hui, nous ne sommes que 102 membres. Après le retour de l’accalmie en Côte-d’Ivoire et face aux difficultés de réinsertion, plusieurs membres de notre associations ont regagné le territoire du voisin du sud du Mali », a-t-elle précisé.
Mme Dabou Diya Koné, arrivée dans un des convois de rapatriement de maliens de la Côte d’Ivoire, est restée seulement cinq mois au Mali. « J’ai pas pu m’adapter à la vie à Bamako. J’ai été obligé de me retirer au village avec deux de mes enfants et ma petite fille qui était à bas âge. Mais, là le manque de moyens financiers, m’a obligé de repartir en Côte d’Ivoire pour rejoindre mon mari, d’autant plus que la crise avait cessé », nous a indiqué au téléphone la quinquagénaire malienne originaire du cercle de Tominian et installée en Côte d’Ivoire depuis sa jeunesse.
La réinsertion socio économique par la transformation des produits locaux
Comme Mme Dabou Diya Koné, nombreuses sont les maliennes rapatriées qui n’ont pas pu s’insérer dans le tissu socio-économique du Mali à leur retour catastrophique au pays, à la faveur de cette crise. Pour la plupart, elles sont reparties vivre en Côte d’Ivoire auprès de leurs maris qui n’avaient pas bougé malgré l’insécurité, de peur de perdre leur emploi.
« Dans le cadre de notre association, celles qui étaient fatiguées de l’émigration en Côte d’Ivoire et qui n’avaient plus envie de quitter le Mali, malgré les difficultés, ont décidé d’initier des activités génératrices de revenus, focalisées sur la transformation des produits agricoles locaux », nous a indiqué Mme Coulibaly Oumou Coulibaly.
Elle a précisé que grâce à l’expérience acquise par un certain nombre de femmes membres de son association, lors de leur séjour en Côte d’Ivoire, elles ont décidé de transformer le manioc et ses dérivés, pour la commercialisation de l’attiéké, le gari et le tapioca. « En plus de la transformation du manioc et de ses dérivés, nous commercialisons aussi le fonio précuit pour joindre les deux bouts », a-t-elle ajouté.
Parti de rien et à force de persévérance, au regard de la pertinence de la démarche, l’Association des rapatriées maliennes de Côte d’Ivoire va enregistrer l’arrivée d’un certains nombre de partenaires pour la soutenir dans ses initiatives. Ce sont : L’ONG GUAMINA, l’APROFEM, le Fonds de la solidarité nationale, la Fondation pour l’enfance, Quatar Charity vie bonne, Muslim hand international et le ministère des maliens de l’extérieur à travers la délégation générale des maliens de l’extérieur.
« Nous n’avons pas beaucoup de cas de réussite de réinsertion. Mais, il y a l’exemple de l’Association des femmes rapatriées maliennes de la Côte-d’Ivoire. Ces femmes ont su s’investir avec beaucoup de réussite dans la transformation des produits agro-alimentaires », nous a indiqué Mme Diarra Mariam Savané, chargée à la promotion du genre et de l’autonomisation des femmes au Haut conseil des maliens de l’extérieur. Même si, elle reste convaincue que ce n’est pas toujours évident de pouvoir se réinsérer dans son pays d’origine, après de longues années passées à l’extérieur. « Souvent, la réinsertion impose qu’on reprenne tout à zéro et cela demande une réadaptation et cela n’est pas toujours facile. D’où de nombreux échecs », a-t-elle estimé.
Citées comme un exemple de réussite de la réinsertion d’un certain nombre de femmes maliennes rapatriées de Côte d’Ivoire, les activités génératrices de revenus de l’Association des rapatriées maliennes de Côte d’Ivoire, connaissent cependant d’énormes difficultés.
Selon Mme Coulibaly Oumou Coulibaly, l’on peut aujourd’hui dire que l’Association des rapatriées maliennes de Côte d’Ivoire a atteint 60% de ses objectifs. « Nous avons une coopérative d’habitat pour la réalisation de logements sociaux pour nos membres. Dieu merci, aujourd’hui chaque membre est propriétaire d’une parcelle à titre d’habitation à Mountougoula. Mais, comment les mettre en valeur, étant attendu que nos revenus sont très limités », a-t-elle indiqué. Elle a aussi estimé que le fait que les différentes activités de l’Association sont pratiquées dans des locaux dont le loyer minimum s’élève souvent à 150 000 FCFA par mois, constitue d’énormes difficultés pour leur pérennisation. Selon elle, la construction du Centre multifonctionnel de l’Association des rapatriées maliennes de Côte d’Ivoire, sur le site de Mountougoula, sera une solution à ces difficultés. « Mais nous avons des difficultés énormes pour avoir des partenaires qui puissent nous aider à supporter une partie du financement de ce projet », a-t-elle révélé.
Elle a aussi mis le doigt sur des difficultés que son association rencontre avec les douanes maliennes, lors de l’importation de la pâte de manioc de la Côte d’Ivoire. « Le Manioc ou la pâte de manioc, constitue la matière première de notre principale activité. Mais, nous n’arrivons pas à comprendre pourquoi les douanes maliennes nous imposent le payement de taxes douanières qui sont de nature à tuer l’activité », a-t-elle dénoncé. Avant de dire qu’elle sollicite l’indulgence des services des impôts et de la Mairie qui leur font payer des taxes et des impôts insupportables, malgré la nature sociale et à la limite humanitaire de leurs activités.
Assane Koné
Cette enquête a été réalisée en collaboration avec l’Institut Panos Afrique de l’ouest
Voir en ligne : Transformation des produits agro-alimentaires : Un cas de réinsertion réussie de femmes maliennes rapatriées de la Côte d’Ivoire