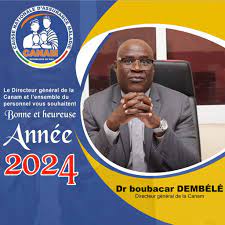Santé > Jean-François Guégan : « La déforestation est une des causes d’Ebola »

Jean-François Guégan : « La déforestation est une des causes d’Ebola »
samedi 15 novembre 2014, par
Jean-François Guégan, directeur de recherches à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) de Montpellier, travaille sur les rapports entre environnement et maladies infectieuses. En faisant une analogie avec ce qui a déjà été observé dans d’autres régions du monde, en Asie notamment, il avance l’hypothèse que la déforestation en Afrique de l’Ouest a contribué à l’émergence de l’épidémie d’Ebola.
RFI : Quel est le lien entre déforestation et épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest ?
Jean-François Guégan : Le phénomène de déforestation perturbe des habitats qui peuvent être des habitats naturels pour des chauves-souris et qui sont les réservoirs d’un certain nombre de virus dont le virus Ebola. Ces chauves-souris ne trouvent donc plus les fruits avec lesquels elles s’alimentent. Beaucoup de chauves-souris sont en effet frugivores, dont celles suspectées être les réservoirs du virus Ebola. En quittant leurs habitats naturels par manque de nourriture, elles vont donc se réfugier à proximité de villages, là où elles trouveront des manguiers, en particulier en Afrique de l’Ouest, pour se nourrir. Elles viennent et augmentent alors les contacts avec les individus et les populations humaines.
Qu’est-ce qui a causé cette déforestation en Afrique de l’Ouest ?
La déforestation en Afrique de l’Ouest correspond à la coupe de bois, d’essence de bois rares en particulier, pour alimenter le marché de l’exportation.
Mais c’est parce qu’il y a eu des mouvements de population dans cette zone ?
Il y a environ entre huit à douze ans en arrière, on a en effet assisté dans cette zone de Guinée forestière à des mouvements importants de réfugiés depuis la Sierra Leone et du Liberia, parce que ces deux pays ont subi toute une longue période de troubles sociaux et politiques, de guerres civiles. Ces populations migrantes se sont installées en Guinée forestière et ont dû s’alimenter. Pour cela, elles ont pu commencer un début de déforestation pour développer une agriculture de subsistance ; planter du manioc, planter du maïs, mais aussi chasser, en particulier de la viande de brousse. Ce qui a sans doute contribué à augmenter les contacts et l’exposition à des hôtes, réservoirs de ce type de virus.
Est-ce que l’exploitation minière en Guinée a aussi joué un rôle ?
Possiblement, cela reste à vérifier, mais vous avez un peu plus à l’est une importante exploitation minière. La Guinée, la Sierre Leone et le Libéria, sont des zones extrêmement riches en différents minéraux. Vous avez de la bauxite, énormément d’or et de diamants dans toute cette zone. L’exploitation minière a ainsi contribué à une certaine forme de déforestation dans les sites miniers et donc un départ possible de chauves-souris de ces zones occupées par l’homme est perturbé.
Vous dites donc que la déforestation, en perturbant l’habitat naturel des chauves-souris, a augmenté les contacts entre l’animal et l’homme ?
Pour le moment, pour le cas du virus Ebola et les épidémies que l’on observe dans cette zone d’Afrique de l’Ouest, je le répète, il s’agit bien d’une hypothèse, mais une hypothèse qui est confortée, si vous faites une analogie avec ce que nous savons pour d’autres virus transportés par ce même type de chauves-souris, qui sont les chauves-souris de grande taille qu’on appelle des mégachiroptères. On trouve certaines autres espèces de ce type en Asie du sud-est, et ce sont des réservoirs d’un autre type de virus, de deux virus en particulier, qui sont le nipah virus et l’hendra virus.
On sait que des mouvements de déforestation importants en Indonésie sont responsables de la fuite d’une grande quantité de chauves-souris qui ne trouvent plus là les fruits pour se nourrir, et viennent se réfugier dans des fermes à Singapour, en Malaisie, mais sont capables d’aller au-delà, d’atteindre même les côtes du Bangladesh et d’Inde.
On sait qu’énormément de zones actuellement dans le monde sont perturbées par le phénomène de déforestation. On observe même l’augmentation du nombre de cas atteints de maladies infectieuses, certaines étant nouvelles, dans beaucoup de zones déforestées aujourd’hui.
Pour parler de l’Afrique de l’Ouest, si on sait que la déforestation augmente le risque, qu’est-ce qu’on peut faire pour inverser la tendance ?
On pourrait penser qu’en replantant des arbres vous stopperiez, en tout cas enrayeriez, ce phénomène infectieux. Or, ce n’est pas du tout vrai. Tout d’abord parce que pour certaines espèces d’arbres, il faudra attendre huit ans, dix ou quinze ans, avant qu’elles ne produisent des fruits et donc de voir un retour des chauves-souris. Et puis comme dans beaucoup de systèmes naturels, vous arrivez à un moment de rupture où le retour à la situation initiale peut devenir extrêmement difficile.
Alors, que faut-il faire ?
D’abord, informer les populations de ce phénomène. Leur dire que ce n’est pas parce que vous allez avoir des chauves-souris dans un manguier, que vous allez automatiquement avoir quelques cas ou le développement d’une épidémie. L’important, c’est le contact avec ce que l’on appelle des fluides. Donc ce sont tous les contacts, les expositions à des animaux morts ou à des animaux tués, dont il faut faire très attention et informer les populations.
Rfi.fr